|
Note de cadrage Note de cadrageConférence Internationale sur l'Ingénierie Culturelle et le Développement du Patrimoine
2ème édition
L’Ecole des Sciences de l’Information organise la deuxième édition de La Conférence Internationale sur l'Ingénierie Culturelle et le Développement du Patrimoine.Ancrée d’ores et déjà dans la ligne scientifique interdisciplinaire de cette manifestation scientifique, la thématique de cette deuxième édition porte sur le développement et la circulation des biens et produits culturels et patrimoniaux à l’épreuve des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Elle interroge les cadres et les enjeux de cette dynamique et de ce mouvement ainsi que les enjeux que soulève l’usage du numérique et des technologie et outils de l’intelligence artificielle dans les champs de la culture, de l’art et du patrimoine culturel. En focalisant sur cette thématique, les travaux de la deuxième édition de la conférence questionnent les changements et les transformations à l’œuvre dans les champs de la culture de l’art et du patrimoine et dans les secteurs des industries culturelles et créatives, la démarche méthodologique attendue étant analytique et empirique. Bastions des sociétés, des nations et des civilisations, la culture, l’Art et le patrimoine culturel sont approchés aujourd’hui à l’aune de paradigmes sociaux et écologiques : communautés, durabilité, inclusion, résilience, développement durable. En effet la mobilisation de ces paradigmes sociaux et écologiques par des organisations internationales, les politiques publiques, les institutions culturelles et patrimoniales ainsi que les acteurs de développement en général attesterait de la mission et du rôle de l’Art, de la culture et du patrimoine dans le développement des sociétés et la préservation de la diversité. En ce sens les solutions technologiques seraient un facteur de diffusion, d’accessibilité et de démocratisation de l’art et du patrimoine auprès du grand public et auprès des communautés concernées. Néanmoins les enjeux de la traduction de cette vision sociale inclusive et durable et des usages des solutions technologiques demeureraient nombreux. Le numérique est largement utilisé dans le champ de la culture, de l’art et du patrimoine culturel pour des besoins de recherche scientifique d’une part et pour des objectifs de documentation, de management, de communication et de démocratisation d’accès aux contenus culturels et patrimoniaux de l’autre. Il permet dans certains cas et situations - catastrophes, zones de conflits- de préserver la mémoire d’un lieu, d’un site, d’un objet et de les recréer grâce à des données scientifiques et sociales, et grâce aux technologies numériques. Aussi les institutions culturelles et patrimoniales, notamment les bibliothèques, les musées et les archives s’engagent dans le processus de numérisation pour s’adapter à cette connexion des mondes réel et virtuel.Pour remplir leurs missions de développement et de préservation des fonds et collections qui demeurent majeures, les musées entreprennent la numérisation de leurs collections et de leurs expositions dans un objectif de diffusion et de communication, d’accessibilité et de démocratisation des contenus artistique et patrimoniaux. L’usage de solutions technologiques -numérisation de documents textuels, sonores et audiovisuels, traitement d’images, reproduction des œuvres en 3D- participent d’une part à une large communication et médiation, notamment dans les musées, via les visites en ligne, les expériences immersives et ludiques et la réalité augmentée, de l’autre à l’accueil de nouvelles compétences et métiers au sein des musées. Aussi une nouvelle économie du virtuel se développe dans les musées et dans les organisations culturelles et patrimoniales en général. De même, l’intelligence artificielle s’introduit dans le champs culturel et patrimonial. Premières « œuvres » générées par l’IA, premières introductions de ces « œuvres » dans le marché de l’art international, mais aussi organisation d’une première exposition sur les deepfakes, Deepfakes and you en 2024 à l’ONU à New York qui alerte sur les risques de la manipulation des images par les outils de l’IA, et une exposition à Paris la même année : Apophénies, interruptions : Artistes et intelligences artificielles au travail au Centre George Pompidou. Les apports de l’usage des technologies de l’IA pour les institutions culturelles et patrimoniales, et aussi le développement de la recherche sur les apports de l’IA pour documenter et préserver le patrimoine vivant, en l’occurrence le projet I-Treasures de l’Union Européenne et de l’UNESCO en collaboration avec des centres de recherche, et plus largement l’utilisation de l’IA dans le champ culturel, artistique et patrimonial relancent le débat sur le régime juridique, sur l’éthique et sur la question de l’ouverture et la protection des données . Le développement des biens culturels et leur production résultant de processus sociaux et institutionnels de communautés, sociétés et nations connaissent aussi de nouveaux essors à l’ère postmoderne. L’on pourrait en effet relever l’interférence et la superposition aujourd’hui de logiques et de dynamiques - sociale et communautaire, étatique, économique et entrepreneuriale - aussi bien que l’interférence de cadres et modes de gouvernance, locaux, nationaux et supranationaux. In fine, de la circulation des savoirs et savoirs faire traditionnels à la « circulation » des œuvres, des fonds et des collections physiques ou virtuelles, de manuscrits et de livres, à l’organisation d’expositions supranationales, le débat sur le mouvement des biens et des produits culturels ne cesse de se renouveler. Dans les années 50 du siècle dernier, Aimé Césaire défendait et préconisait déjà la circulation des biens culturels entre les nations et les continents, entre le Nord et le Sud face au trafic illicite des patrimoines culturels africains et dans le monde. En 1978, Amadou-Mahtar M’Bow, Directeur Général de l’UNESCO (1974– 1987), lançait un appel pour le retour des biens culturels aux pays qui les ont perdus, et pour un échange international plus juste des biens culturels qui s’inscrivait dans l’esprit de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant le trafic illicite des biens culturels et patrimoniaux. Aujourd’hui plusieurs cadres, méthodologies et outils permettent de réguler cette circulation. De même, plusieurs organisations publiques et privées - musées, archives, bibliothèques, fondations, entreprises du marché de l’art - participent à des formes de circulation nationales et supranationales des biens culturels. Aussi l’offre numérique des institutions et des organisations culturelles et patrimoniales contribue à ce mouvement des œuvres, des collections et des documents dans le monde virtuel. En ce sens, seront interrogés les cadres et les régimes qui régissent ce mouvement, sur le plan national et supranational ainsi que les enjeux que la circulation des biens et produits culturels et patrimoniaux soulève. Axes scientifiquesI. Patrimoines culturels : perspectives et défis du développement, du numérique et de l'intelligence artificielle
II. Les industries culturelles et créatives : de l'œuvre au produit industrialisé et/ou numérisé
III. Circulation des biens et produits culturels, artistiques et patrimoniaux : les cadres et les enjeux
Modalités de soumissionLangues de la conférenceLes communications peuvent être présentées en arabe, français ou anglais.
Soumission du résuméLes contributeurs sont invités à envoyer un résumé de 500 mots dans l’une des langues du colloque présentant la problématique, l’objet de recherche, la méthodologie mobilisée ainsi que 5 mots clés à soumettre via la plateforme en appuyant sur Nouvelle soumission
Modalités de soumission des textes de communicationLa première page comprend nom, statut et rattachement institutionnel de l’auteur-e(s) et coordonnées ; la deuxième page le titre de la communication, l’intitulé de la communication et 5 mots clés. Le texte de la communication doit comprendre entre 3000 et 5000 mots, Times New Roman taille 14 pour Les titres et Times New Roman taille 12 pour le texte. Les références bibliographiques doivent être rédigées selon la norme APA. Les textes de communications sélectionnés par le comité scientifique seront publiés en 2026.
Modes de participation et prise en chargeLa conférence est en mode hybride. Les intervenants qui optent pour la participation en présentiel doivent supporter les frais de transport et d’hébergement. Ils sont toutefois exonérés des frais de participation à la conférence.
ContactPour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter : ICCEHD.2025@esi.ac.ma Partenaires School of Information Sciences
مدرسة علوم المعلومات
École des Sciences de l'Information
Avenue Allal El Fassi, Cité Al Irfane, Rabat-instituts, Rabat, Morocco.
شارع علال الفاسي، مدينة العرفان – الرباط
Phone: +212.537.774.904 Fax: +212.537.770.232 Web: www.esi.ac.ma Email: ICCEHD.2025@esi.ac.ma Map: X4JM+RV Rabat
|



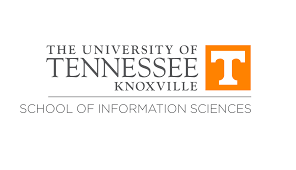


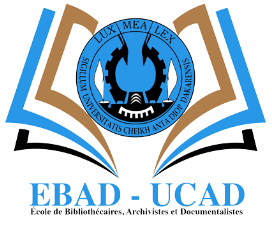 >
>
